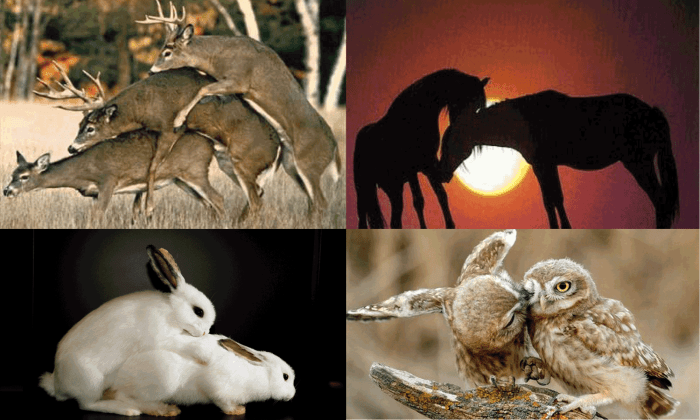Oui, je sais, nous ne sommes pas dans la saison des papillons. Vous ne m’apprenez rien, je suis sorti dehors pas plus tard qu’aujourd’hui et la pluie verglaçante, les bancs de neige et le bal des déneigeuses me l’ont clairement montré. Alors pourquoi un papillon me ferait-il rager en plein cœur de l’hiver ? C’est que je parle d’un foutu papillon coriace, une teigne indécrottable, un papillon de calibre himalayen. Vous le voyez ? Non ? Attendez un peu et vous comprendrez tout.
Ouais, je vois votre petit sourire en coin, votre œil condescendant et votre main me tapotant le dos en me disant que tout ira mieux demain tout en sachant pertinemment que demain, rien n’aura changé. LeCorbot fait de la fièvre à l’année, il pète des bulles que lui seul voit, il saute une coche ou des coches sans préalablement préparer convenablement ses lecteurs ahuris.
Bon, j’avoue, être LeCorbot à longueur d’année, ça joue sur les nerfs, les vôtres, mais surtout les miens. Je suis quand même assis dans la première rangée, je vous le signale et s’il réussit à m’énerver, je vous imagine stressés et je vous plains. Mais vous ne connaissez pas ce putain de papillon, sinon vous seriez vous aussi en train de mordre les sangles de la chemise blanche à très longues manches qu’on vient de me passer ! Comment fais-je pour écrire ? J’ai du nez, ça aide, il ne faut pas se presser. Et puisqu’on vient tout juste de me signifier que je passerai un méchant bout de temps en dedans, j’ai tout mon temps.
Je pousse des jurons que très rarement, mais là, franchement, je n’en peux plus. Le prochain qui me parle de cet enfoiré de papillon, je lui ferai subir les affres de mes incantations vaudou, version 2.0. Oui, je viens de les améliorer en égorgeant, en étripant, en écartelant et en faisant brûler la fameuse marmotte censée prédire sous peu l’arrivée du printemps. Oui, oui, j’avoue, certains animaux me tournent en bourrique. Hé ! Bourrique, c’est un âne, alors le compte est maintenant rendu à 3. Un papillon, une marmotte et maintenant un âne. Ne manque plus qu’un poisson pour compléter ma collection des animaux peuplant tous les écosystèmes de mon intolérance.
Mais avant, juste avant de me considérer irrémédiablement cinglé pour oser m’en prendre à une créature aussi inoffensive que le gentil papillon gnan ! gnan !, donnez-moi la chance de prouver mon point et vous direz comme moi, quoique j’en doute, vade retro papilio satana.
Bon, voilà que mon nez coule à cause de la grippe. Il m’est impossible pour l’instant de vous écrire sans faire risquer la noyade à mon clavier. Vous devrez attendre demain pour enfin savoir pourquoi cette infernale bestiole me rend aussi fou. Non, c’est vrai, j’étais fou bien avant de la rencontrer, mais elle n’a absolument rien arrangé. Demain, je vous le promets, vous saurez pourquoi ce papillon me tape autant sur le système.
Ne soyez pas triste de cette attente forcée. Dites-vous au contraire que vous aurez vécu un jour de plus dans votre vie sans avoir connu ce détestable fléau qui vous poursuivra par la suite, sans relâche, pour le reste de votre existence soudainement devenue misérable, pour ne pas dire minable, pour les siècles à venir.
Demain, je vous promets de me forcer à ne pas donner des noms d’oiseaux au vilain papillon et à passer directement au propos principal. Tiens, ça me fait penser, je vais déposer une plainte à l’Académie de la langue française pour qu’on cesse d’associer les noms d’oiseaux à des jurons pour les remplacer par des noms de papillons, bien plus signifiants à mon avis. Entre ces deux espèces volantes, vous verrez, une vilenie sans aucune commune mesure émane du papillon.
Il faut bien que je défende ma propre espèce ! Sinon, qui le fera ? Certainement pas le papillon ! Avec toutes mes insultes, sa complicité avec ceux-là mêmes qui m’ont enfilé une camisole au style très peu tendance est fortement suspecte.
Je vous laisse, je dois me moucher… mais comment vais-je bien m’y prendre ?
Photo : planete.qc.ca