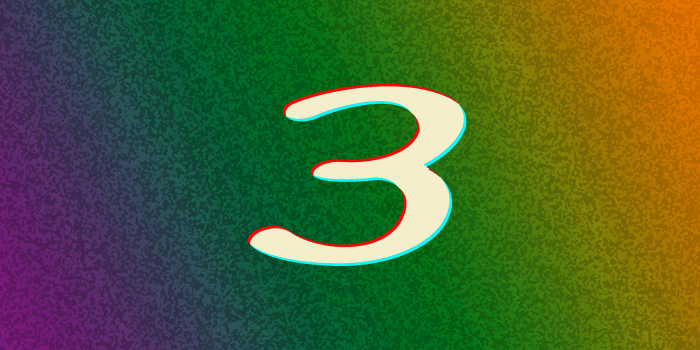Aujourd’hui, une expression très simple qui me servira de prétexte pour donner la définition de quelques mots associés qui sont parfois absents des dictionnaires français ou qui présentent une définition différente de celle que nous utilisons.
L’expression est : « Tire-toi une bûche ».
Je vous parle d’une vieille expression datant de nos ancêtres colons. À cette époque, le travail de la terre était éreintant puisqu’une grande partie du territoire n’avait jamais été défriché ni essarté. De plus, le froid intense obligeait les colons à couper beaucoup de cordes de bois (1,8 stères) afin de passer les hivers au chaud. Une véritable corde de bois correspond à un cube de 4 pieds, par 4 pieds, par 4 pieds de bûches de bois fendu. 4 pieds correspondent à 1,22 mètre. On utilisait une corde de cette longueur pour mesurer l’empilement compact des quartiers de bûches prêts à être brûlés dans les poêles à bois ou les foyers. Il n’était donc pas rare d’arriver chez quelqu’un et qu’il soit en train de débiter du bois. L’arbre s’abattait à l’aide d’une hache à deux lames. Une fois l’arbre abattu et ébranché, il était étêté pour que la bille de bois mesure un multiple de 4 pieds. De là, on obtenait une pitoune de bois standard qui était tirée par des chevaux de trait ou plus efficacement en la jetant à la rivière pour la drave, une opération consistant à diriger d’énormes tas de pitounes sur une rivière pour les faire descendre le courant jusqu’à un moulin à scie. Un travailleur spécialisé dans la drave est un draveur. J’en ai connu un qui avait plus de 90 ans et qui me racontait ses histoires de drave. Il ne devait pas peser plus de 50 kilos. Son poids plume l’avait conduit à être celui qui plaçait la dynamite lorsqu’il fallait détruire un embâcle. Une fois la mèche allumée, il devait s’éloigner le plus vite possible en sautant d’une pitoune à l’autre jusqu’en lieu sûr. Ce travail était extrêmement dangereux puisque les pitounes sont mouillées, glissantes, instables et elles tournent facilement sur elles-mêmes. La plupart des mortalités dans ce métier étaient justement dues à des chutes entre deux pitounes qui écrasaient le travailleur ou à des noyades lorsqu’un malheureux ayant passé à travers le radeau était incapable de retrouver la surface.
Lorsqu’on coupait des arbres pour ses besoins personnels, les pitounes étaient tranchées en bûches de 16 pouces de long à l’aide d’un sciotte, une lame de scie montée sur un cadre en bois en forme de C, ou en duo avec un godendard, une très grande lame de scie seulement munie d’une poignée en bois à chaque extrémité où les utilisateurs tirent la lame vers eux chacun à leur tour. Vous n’avez probablement jamais manié un godendard. Je vous jure que ça prend une excellente technique, une bonne coordination entre les partenaires, ainsi qu’une endurance… de bûcheron. En revanche, un arbre de 50 centimètres et plus n’impressionne pas cet outil qui peut passer au travers d’une bille de bois couchée à l’horizontale en une dizaine de secondes lorsque le godendard est manié de façon adéquate.
Pour revenir à notre expression, « tire-toi une bûche », elle a dépassé aujourd’hui le cadre initial qui signifiait littéralement que l’invité était convié à se choisir une bûche et à la rapprocher pour s’asseoir quelques instants. Aujourd’hui, elle s’est répandue dans le quotidien même si on ne débite plus son bois et qu’on ne s’assoit plus sur des bûches, sauf parfois en camping.
Sa signification est : « Prends une chaise et assieds-toi qu’on cause quelques instants ».
L’idée initiale était que l’hôte signifiait à la personne arrivée parfois à l’improviste qu’il s’accordait un moment de répit et qu’elle pouvait se choisir une bûche de bois pour s’asseoir. Maintenant, on utilise cette expression familière entre amis ou avec des personnes qu’on cherche à mettre à l’aise pour une discussion sans fla-fla, à la bonne franquette. Évidemment, les bûches ne servent plus de siège depuis longtemps, mais l’expression est restée comme signe de convivialité et d’hospitalité. Alors, si vous venez nous visiter et qu’on vous dit « tire-toi une bûche », soyez assuré que la discussion s’aligne pour être amicale et détendue, mais ne cherchez pas la bûche. Et si par hasard vous en trouvez une près d’un foyer, dites-vous que notre intention n’est vraiment pas de vous offrir le plus mauvais siège possible. Et de grâce, ne vous la tirez surtout pas !